Leanna Lenee fires back at fans criticizing her relationship with Travis Hunter’s mom

Leanna Lenee just offered the perfect response to haters critiquing her relationship with Travis Hunter’s mom.
On Monday, Dec. 15, Lenee shared a video tagging the Jacksonville Jaguar rookie’s mother, Darlene King.
While dancing around her living room to the classic Juvenile song “Back that a– up,” Lenee wore an oversized T-shirt with Hunter’s face across the front.
“Does your mother in law know you act like that,” the NFL WAG wrote in a text overlay across the clip.
Moments later, the Colorado Buffaloes alum’s mother joined the video, dancing in sync beside her with a huge smile on her face as the words “My mother in law” appeared across the screen.
MORE: Why Travis Hunter’s wife Leanna was crying in viral TikTok that sparked divorce rumors
Travis Hunter’s mom shares opinion on daughter-in-law Leanna Lenee
While some people may assume that Lenee doesn’t have a close relationship with her mother-in-law, that’s clearly not the case, as King even commented on the video, “I love you forever.”
“Forever,” Lenee responded.
Fans were quick to praise the NFL cornerback and wide receiver’s wife for correcting the haters who continue to throw negativity her way.
“That’s right and she knows YOU & loves YOU,” one person commented.
“genuinely love this especially for the haters 😌,” a second wrote.
“Like mother like daughter,” another added.
@leannalenee6 @Darline King ♬ original sound – SP
Lenee married Hunter in May 2025 in a romantic ceremony in Tennessee after three years of dating.
The couple announced that they secretly welcomed their first child, a baby boy, in an Aug. 27 YouTube vlog posted on Travis’ account titled, “Dear Son.”
Read more lifestyle news:
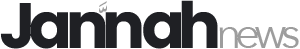


![[포토타임] 연일 최강 한파…내일 아침 -19도](https://cdn2.el-balad.com/wp-content/uploads/2026/01/포토타임-연일-최강-한파…내일-아침-19도.webp)
